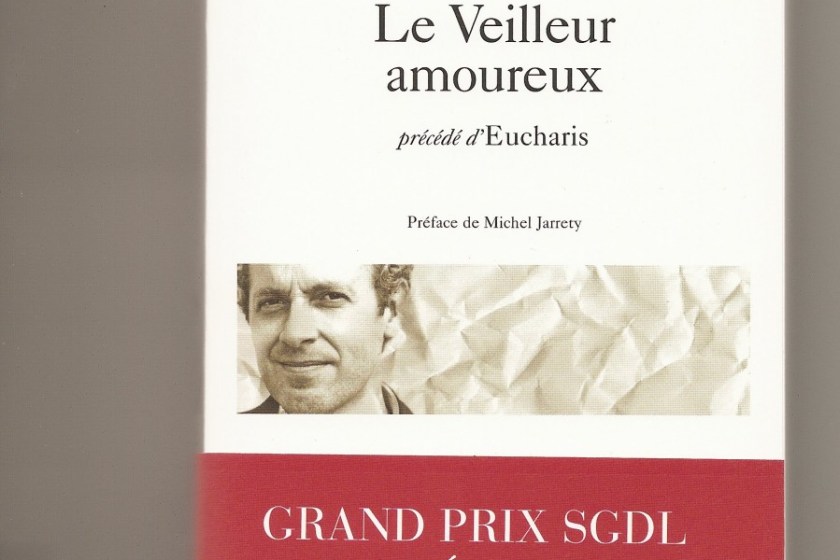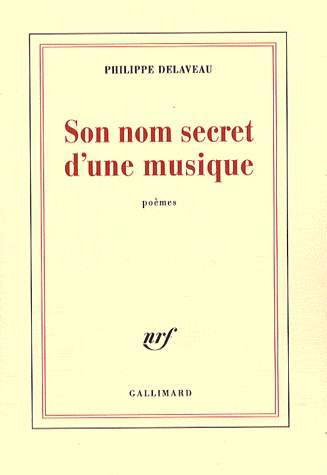Né à Paris en mai 1950, Philippe Delaveau est issu d’une famille d’origine tourangelle. Il passe son enfance à Paris, en Touraine, et séjourne régulièrement en Angleterre. Les paysages des Moors, la côte anglaise et Londres, très tôt le fascinent. Il se passionne pour la musique – Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, les contemporains, et rêve de devenir compositeur et chef d’orchestre ! Il découvre la littérature : Balzac et Rabelais, puis pénètre dans le royaume de Poésie : Hugo, Baudelaire, Rimbaud, Max Jacob… Après des études aux Lycées Montaigne, Louis-le-Grand, puis Henri IV, il intègre l’ENS de Saint-Cloud et poursuit des études de Lettres Modernes et d’Histoire à la Sorbonne. Passionné de musique, il se rend quand il le peut au concert, tourne les partitions des Duruflé à la tribune de Saint Etienne du Mont. Parallèlement, il s’inscrit à l’École du Louvre et entreprend des études de piano. Guy Lévis Mano lui révèle Jouve et Georges Schehadé. Il lit quelques rares poètes contemporains, dont Jacques Réda, qui l’enthousiasme. C’est sa rencontre avec Jean Follain qui sera décisive. Mme Romain Rolland l’entraîne chez Aragon. Julien Green, lui fait découvrir les arcanes de l’écriture romanesque. Il fréquente, chez la fille de Jean Croué, des comédiens dont il s’inspirera pour inventer son personnage d’Elvire van der Kruk (Cent sous pour la reine Mab, éditions de La Différence, 2001). Il lit alors à Jean-Claude Renard, dans son bureau des éditions Casterman, les poèmes qu’il avait écrits pendant ces dernières années. Renard lui conseille de rencontrer Jean Grosjean et le présente à Pierre Oster, par lequel il rencontrera Jacques Réda. Reçu à l’Agrégation de Lettres Modernes, il est chargé de cours à la Sorbonne.
Envoyé pendant six ans à Londres à l’Institut français (1982 – 1988) avec sa femme et leurs trois enfants, il participe aux activités culturelles, rencontre des poètes anglais comme Kathleen Raine, Anthony Rudolf, Jonathan Griffin, qui lui font découvrir à leur tour l’oeuvre de Ted Hughes, Sylvia Plath – et de ces grandes figures d’aînés: Eliot ou Dylan. Il fréquente des peintres comme Philippe Lejeune, Chapelain-Midy, René-Jean Clot… et se lie d’amitié avec poètes et romanciers : Jean-Claude Renard, Jean Grosjean, Pierre Oster, Paul de Roux, Jean-Pierre Lemaire, puis Jacques Réda, ou encore Michel Déon, connu en Angleterre.
À son retour en France, il publie son premier recueil chez Gallimard : Eucharis (1989), marqué par l’Angleterre, qui lui vaudra le prix Apollinaire. Le livre est salué par de nombreux articles. « Coup de cœur » de TF1, « coup de cœur » du Nouvel Observateur dans lequel paraîtra également un article enthousiaste de Claude Roy qu’il rencontrera par la suite. Paraît ensuite Le Veilleur amoureux (1993), repris avec le précédent recueil en « Poésie/Gallimard », avec une préface de Michel Jarrety (2009). Il partage alors son temps entre l’écriture, les lectures, les voyages, les cours de littérature. Sa poésie lui ouvre le monde et lui permet d’élargir son regard d’écrivain : Les Secrets endormis, Impressions du Mexique en collaboration avec Bernard Pozier (1993) ; Labeur du Temps (1995). Son recueil Petites gloires ordinaires reçoit le prix Max Jacob en 1999. Il entreprend, grâce à Michel Déon, un travail de collaboration avec des peintres tels que Julius Baltazar et Jean Cortot, puis Bertemès, Laubiès, Hélénon, Pouperon, autour du galeriste André Biren et réalise avec eux de nombreux livres peints.
En 2000, il reçoit le Grand Prix de Poésie de l’Académie française pour l’ensemble de son œuvre.
En 2001, Françoise Seigner (et l’auteur) créent au Théâtre du Rond-Point des Champs-Élysées (direction Marcel Maréchal), pour France-Culture, « Un toast pour la Reine Mab », à partir de Cent sous pour la reine Mab. En 2007, Philippe Delaveau est élu à l’Académie Mallarmé, aux jurys du prix Apollinaire et du Prix Léopold Sédar Senghor (Nouvelle Pléiade).
Sociétaire du P.e.n.-Club et de la Société des Gens de Lettres (SGDL), qui lui décerne son Grand prix de Poésie pour l’ensemble de son œuvre (2010).
Il reçoit en 2012 le prix de poésie Alain Bosquet “pour l’ensemble de l’oeuvre”, le prix Omar Khayyam, le prix Rainer-Maria Rilke (Confédération helvétique) ainsi que le prix de la Ville de Lyon – Roger-Kowalski.
Entretien avec ce poète des temps modernes, tour à tour veilleur et prophète, qui souffle sur notre époque un vent magistral d’absolu à travers le savant usage des mots.
Quelques dates clés :
Prix Guillaume-Apollinaire (1989), Prix Max-Jacob (1999), Grand prix de poésie de l’Académie française (2000) “pour l’ensemble de l’oeuvre”, Grand prix de poésie de la SGDL (2010), “pour l’ensemble de l’oeuvre”, Prix de poésie Alain Bosquet (2012), “pour l’ensemble de l’oeuvre”, Prix Omar Khayyam (2012), Prix Rainer-Maria Rilke 2012 (Confédération helvétique), Prix Ville de Lyon – Roger-Kowalski (2012).
Découvrez le dernier recueil de poèmes de Philippe Delaveau intitulé Invention de la terre qui vient de paraître chez Gallimard dans la Collection Blanche :

Joie, c’est le mot qui revient le plus souvent dans ce recueil de poèmes et qui en résume l’essence et le sens. Joie en dépit des jours perdus dans la tristesse et la désespérance d’un siècle en pleine confusion. Joie «devant le sens inépuisable que toute chose ici-bas découvre à qui sait voir» : beauté des saisons, richesse des paysages et des personnes, tout ce qu’enseignent les voyages, les arts… Joie pour qui vit au présent et croit en la promesse de la résurrection. Joie magnifiquement exprimée ici dans la beauté calme de ces vers libres, leur cadence, leur variété de forme, leur amplitude. Bref, voici un recueil construit comme une pyramide bâtie sur le réel et la réalité de nos vies et dont tous les plans convergent vers le ciel. Catalogue Gallimard, novembre 2015.

- Vous considérez-vous comme une figure littéraire ?
Philippe Delaveau : À peine ! Le poète est un être invisible aujourd’hui, pas même une ombre qui traverse la ville. La société française lui ôte tout emploi dans la préoccupation du quotidien – et même de l’exception. Autrefois, on pouvait concevoir, pour en rire, une manière de personnage entre l’ivresse et l’insomnie, un hurluberlu pas méchant, hanté de rimes. La télévision, qui régit tout et distribue les rôles, ne lui accorde plus d’image ni de fonction. La presse écrite non plus. Et le public s’est fatigué de lire des livres qui lui paraissent sans objet. Alors que les poètes peut-être sont les figures du sens qu’ils décryptent, s’ils savent se conformer à leur vocation. Celle-ci commence par la veille dans un monde qui vit avec frénésie, sans recul. Voilà bien la fonction du poète, qui découle de l’écriture du poème : veiller pendant que d’autres dorment – entendons cela de manière symbolique, bien sûr. Veiller pour comprendre, au fond de soi, et dans la nuit du monde contemporain, les signes que nous adressent les objets, les faits, les images.
L’essentiel est bien ce que nous faisons, davantage que l’image que nous croyons donner de nous-mêmes, qui est incomplète et trompeuse, à nos dépens. Là encore, dans un univers de pipolisation, la figure de cet artisan modeste – le poète – qui travaille à son œuvre, sans trop faire de bruit, comme les artisans qui fabriquent des chaussures ou des montres, est une chose parfaitement insolite. Et, crime suprême, il ne gagne pas ou presque pas d’argent ! Cela dit, si je prenais votre question à la lettre, je dirais que je suis, comme tous les écrivains, la métonymie de ce que disent mes livres, ou simplement peut-être la métaphore… Ce sont les livres qui inventent ceux qui les écrivent – les figures de style (rhétorique) qui inventent les figures concrètes de l’homme véritable, l’homme qui invente, l’artiste, au-delà de l’image de l’homme social, qui n’existe qu’en vain, dans une succession d’actes qui le scindent.

René Laubies & Philippe Delaveau
CE QUE DISENT LES VENTS DANS LEUR LANGUE NUE, 2006
- Comment définiriez-vous votre style ?
Philippe Delaveau : Pour commencer, permettez-moi de dire que ce qui m’importe est bien de rechercher la vérité cachée sous les apparences, pour vivre d’une plus grande authenticité. Ce qui m’amène alors à la question du style, mais cette fois-ci à travers la notion même de ce que nous appelons aujourd’hui l’écriture. Je suis soucieux de simplicité et de justesse – deux qualités traditionnelles en France – je veux dire dans la littérature française -, qui permettent d’approcher plus profondément le mystère. En ce sens, je recherche une nouvelle mesure, c’est-à-dire un « beau style bas » comme on disait au 16e siècle, en reprenant Horace – un style qui convienne à son objet : pas d’élévation lyrique saugrenue, pas de langue décomposée, une vive attention à chaque chose dite, sans ivresse, sans gratuité… Un travail particulier sur la langue pour susciter, en la creusant, un langage poétique. Et par ce langage, parvenir à approcher le secret du monde. J’abomine le style prétentieux et savant, et en général tous les masques qui dissimulent la personne et l’écriture. Ce qui ne nie pas, loin de là, cette complexité propre à toute œuvre artistique. En somme, j’aime le mystère illuminé par la lumière, l’opacité traversée par un rayon de jour. Je serais heureux de pouvoir faire coïncider ces deux exigences : justice, dans l’ordre moral ; et justesse, dans l’ordre esthétique…

Poèmes de Philippe Delaveau, peintures de Julius Baltazar
- Qu’est-ce qui vous a poussé vers la Poésie ?
Philippe Delaveau : Je n’ai pas été poussé, comme on dit qu’un voilier, sur le bassin du Luxembourg, est poussé du bâton vers la margelle. C’est la poésie au contraire qui m’a tiré à elle, me faisant découvrir à la fois le ravissement de lire les poèmes des autres, qui m’ont profondément bouleversé un jour, et le bonheur – mais aussi la difficulté ! – d’en écrire. Le bonheur, mais surtout la nécessité : mon désir, à lire les autres, n’était pas satisfait, il me semble que j’ai toujours voulu écrire ce que je ne trouvais pas dans les œuvres des autres, mais aussi me dresser contre telle ou telle écriture contemporaine. Mais je reste persuadé, au départ, de la réalité d’un appel : je crois à la notion de vocation en art – au sens religieux. Chaque poète, chaque artiste, est appelé à une quête, en recevant une certaine intelligence de la langue et du monde pour découvrir les conditions de son propre langage. Il reste alors à descendre au fond de soi pour découvrir ces matériaux nécessaires, ou à être disponible aux sources qui nous traversent, qui nous apportent d’étranges et lumineux éclats du monde.
La chance – mais s’agit-il de chance ? – est bien de tomber au départ sur des poèmes qui nous touchent au cœur et aux tripes. Car sans cette rencontre, la poésie ne peut pas s’imposer comme une véritable nécessité (pas plus que le roman ou le théâtre), jouer son rôle de révélateur. Au départ de toute aventure de création, il y a une rencontre avec une œuvre : dans un musée, à un concert, lors du silencieux corps à corps avec un livre par le truchement des yeux et de la totalité de la personne. On connaît le raccourci toujours mythique : « un jour il entra dans un musée et en sortant, il était peintre. » Si les choses sont toujours plus compliquées, il n’empêche qu’il y a quand même du vrai dans ce coup de foudre pour un art, par lequel un être découvre la nature d’un appel.

- Vous reconnaissez-vous des influences ?
Philippe Delaveau : Oui, bien sûr. On ne sort pas de rien, hors du temps et de l’histoire – hors de sa bibliothèque. Les romanciers et les poètes qui nous touchent – nos vrais contemporains par le dialogue qu’ils instaurent, et donc hors de ce temps – nous apportent beaucoup parce qu’ils nous révèlent ce qui existait déjà, de manière latente, au fond de nous. Ils nous indiquent des directions ,des exigences, ils nous prouvent aussi que tout est possible. Les écrivains qui m’ont le plus apporté, sont ceux qui ont su dégager une voie originale vers la prise de réel, l’incarnation, la saisie du secret des profondeurs. Ceux qui rendent tangibles ce dont ils parlent… Je me méfie d’instinct des textes inutilement désincarnés, seulement conceptuels. J’abomine les théories fumeuses, les vaines discussions sur la littérature, la métamorphose de la page en texte abstrait, dévitaminé.
Au départ, il y a les poètes qu’on lit : Baudelaire, Villon, Verlaine et Rimbaud furent les vrais premiers intercesseurs, de même, les romanciers qu’on admire : Balzac, Dickens, Tolstoï… Puis viennent les vraies amitiés profondes, l’entrée dans une sorte de famille : Dostoïevski, Tchekhov, les poètes russes, et bien sûr, toujours Baudelaire et Rimbaud auxquels s’ajoutaient les poètes contemporains ; la littérature anglo-saxonne, avec Shakespeare en premier lieu – pardonnez-moi, ce n’est pas original – puis Faulkner ; puis les poètes européens : irlandais, anglais contemporains, italiens, grecs.
J’ai eu la chance de rencontrer des poètes et romanciers français dont l’amitié et les conseils m’ont été précieux. Je ne puis les citer tous ici ! Pour n’évoquer que quelques-uns d’entre eux, hélas aujourd’hui décédés, laissez-moi vous citer les noms de Julien Green, Jean Follain, Jean Grosjean, Jean-Claude Renard, Guy Lévis Mano, Aragon…

- Dans quelle mesure les lieux où vous avez vécu ou voyagé ont-ils marqué votre écriture ?
Philippe Delaveau : Tous les lieux par lesquels nous passons, et plus encore ceux où nous habitons quelque temps, où nous avons alors cette relation fondée sur un mélange d’émerveillements et d’inquiétudes – nous révèlent, par des signes nombreux, ce qu’ils veulent que nous sachions des autres et de nous-mêmes. Ils nous laissent entrevoir un peu de ce secret du monde que tout écrivain tente de proférer, avec sa langue et sa musique. C’est parfois loin d’ici – Paris – que la langue française ou quelque aspect de notre culture de Français nous paraît plus compréhensible, du fait de l’étrangeté de la situation. Ce fut Londres, dans mon enfance, et pendant plusieurs années où nous avons eu la chance de résider. Certains lieux m’obsèdent : je pense par exemple à la « Plaine d’Abraham » au-dessus du vieux Québec, d’où l’on a une vue si grandiose sur le Saint-Laurent ; à certains quartiers de México ou de Dublin ; à Belgrade, depuis le parc de la vieille citadelle au-dessus du Danube, à Rome, à Lisbonne… Tout à coup, au détour d’une rue, d’un mur ou d’un paysage, quelque chose nous attend, et tout à coup une révélation nous est faite, et nous recevons ce secret avec les mots qui le disent, avec cette étrange émotion qui accompagne la promesse esthétique. Après, il faudra le déchiffrer, non pas avec des idées, mais avec le lent travail des mots unis en séquences.
Autrement dit, dans un second temps l’artiste revisite le lieu par le souvenir, un souvenir intentionnel qui cherche à repérer les signes à travers des objets, du concret. Nous vivons alors comme dans un étrange rêve – étrange, parce que nous sommes à la fois sous hypnose et conscients de tout ce qui advient, et que, agis par l’écriture, nous agissons aussi sur elle pour parvenir à l’heureux équilibre dont se crée une forme. En somme, le voyage, qui rompt l’habitude, est une redécouverte de l’épaisseur charnelle de la réalité, de ce que j’aime appeler – pardonnez ce néologisme ! – la concrétude.

Lecture à Montréal, octobre 2008
- Le poète est un peu prophète… Quelle est votre vision du monde actuel ?
Philippe Delaveau : Oui, le poète ressent profondément les relations complexes qui se nouent à l’intérieur du monde, et comme il perçoit le temps d’une façon autre que ne le fait l’homme d’affaires, il peut être amené à pressentir des faits, comme s’il les voyait, ou plutôt comme si son poème les voyait, et donc à prononcer, mais le plus souvent à son insu, ces « paroles mystérieuses » qu’évoque la Bible, dont le sens lui échappe le plus souvent. Parfois, il cherche à les interpréter, en tâtonnant. Aussi peut-il parfois tenter de mieux percevoir, à partir de l’expérience du singulier, ce qui relèverait de l’universel, disons les caractéristiques du temps actuel. Mais cette connaissance poétique n’est nullement une prédiction consciente de l’avenir, seulement une façon de déchiffrer un manquement dans le présent, une déperdition dans notre façon de vivre l’instant, de répondre à notre vocation. Les prophéties – en dehors de celles des prophètes appelés par Dieu pour exprimer dans le temps présent sa volonté à son peuple, – sont donc mesurées et la plupart du temps inconscientes : je citerai, pour illustrer mon propos, tel passage de Rimbaud que l’on peut lire comme l’annonce de son amputation, ou de Max Jacob prédisant « la mort allemande ». C’est donc en descendant au plus profond que le poète (ou le romancier, s’il est poète), parvient à lire des réalités qui lui échappent, mais qui seront explicites pour des lecteurs ultérieurement ! Les poètes qui se prétendent des prophètes à la façon de Hugo sont des imposteurs : Hugo n’annonçait rien qu’il ne connût d’autre façon que par la poésie. Certaines personnes, à l’inverse, sont capables de voir loin et de comprendre des choses qui échappent à leurs contemporains – songeons aux mystiques -, sans être pour autant des poètes.
Revenons à notre temps, à la situation de la France actuelle : la non-reconnaissance de la poésie, que le poète vit dans une relation plus profonde avec ses poèmes, une sorte de tête-à-tête, peut être déchiffrée comme le signe d’une crise spirituelle : ce n’est pas la société qui condamne la poésie, mais l’existence de la poésie qui révèle la misère de l’époque, son mal profond, son incapacité à être. Si une civilisation se définit par sa façon de projeter un modèle dynamique en faveur de la vie (de l’homme, de l’enfant, de la nature, de l’art, de l’industrie, etc., etc.) pour contrer les forces mortifères et répondre de façon cohérente aux interrogations existentielles, aux menaces du nihilisme, – le congédiement de la poésie, qui est l’art de rattacher le temps à l’éternel, montre bien que nous ne somme plus dans une ère de civilisation, mais tout au plus sur une aire d’autoroute… une voie qui nous mène à grande vitesse vers quelque chose d’indéfinissable, pour nous y perdre au lieu de nous aider à nous y retrouver !

- Y a-t-il des lieux imaginaires, rêvés ou perdus, qui vous habitent de manière significative ?
Philippe Delaveau : Oui, les lieux qui signifient l’enfance, parce qu’ils sont associés à son mystère, et donc à l’origine – qui est aussi celle de la parole de poésie ou de fiction. Ce sont souvent des lieux très concrets, avec un élément de paysage – arbre, rivière, maison, ciel, etc. – parfois très localisables, mais que la mémoire a transformés pour en faire des lieux obsessionnels, comme si dans leur atmosphère si particulière le secret semblait plus proche de se révéler. Je me souviens en particulier d’un paysage très émouvant, qui m’a parfois remué jusqu’à la plus forte émotion : la petite vallée qui s’étend face à la façade arrière du château de Saché. On peut suivre des yeux ce gros ruisseau, cette petite rivière, entre la forêt d’un côté, les broussailles de l’autre, la vallée est dégagée, mais elle s’éloigne et bascule bientôt dans quelque chose d’indistinct. Cette zone entre le distinct et l’indistinct est précisément l’équivalent du lieu que les poèmes visitent, au fond de nous, où ils retrouvent le lien avec l’inconnu, mais aussi la promesse d’une révélation à venir qu’il faut patiemment déchiffrer.
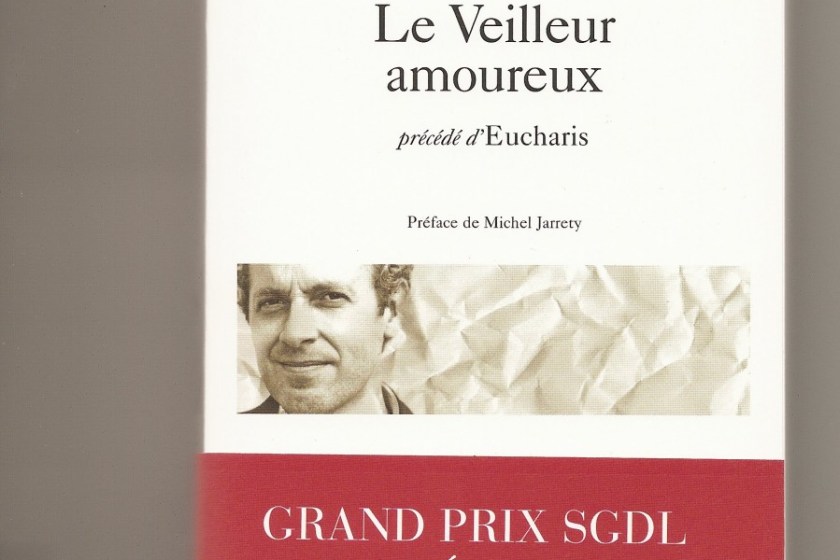
- Comment définiriez-vous le passage entre votre perception d’un lieu, et l’écriture ?
Philippe Delaveau : Longtemps après, et de manière très étrange, les lieux, les gens rencontrés, le moindre objet, s’ils ont quelque chose à me dire, « remontent » à travers moi avec le signe explicite d’une présence, m’invitant à un déchiffrement de ce signe en relation avec mon existence. Généralement cette « remontée » se fait avec des séquences déjà ordonnées, fermées sur elles-mêmes, en attente de formes. Le passage me semble la traversée de ce que je me représente comme une succession de couches et de strates spatio-temporelles – s’agit-il de l’inconscient ? ou plutôt du préconscient spirituel ? En fait il est très difficile de définir où se situe cette zone d’attente et de maturation des signes du monde, – qui sont des images complexes, et dans le cas de l’écrivain, des ordonnances de mots. Mais je sais quelle étrange impression de fébrilité heureuse s’empare du poète au moment où ces séquences s’approchent de sa conscience et avec quelle rapidité il faut noter leur émergence, car elles signifient moins par ce qu’elles disent que par ce qu’elles formalisent. Et si nous n’avons pas su les recueillir à temps, nous ne les rencontrerons plus. A quel rythme cela se fait-il ? à quel moment par rapport à l’expérience de la réalité ? C’est très aléatoire. Parfois ces surgissements ont lieu au petit jour, dans le premier matin des sens, dans la disponibilité de cette sorte d’intelligence inventive, ou bien de manière impromptue, comme dans le cas de la mémoire involontaire, ou bien encore dans le cas de la mémoire volontaire, cette fois-ci, selon des mécanismes inattendus. Une image, une mélodie, une rêverie même, peuvent déclencher tout à coup le surgissement de quelque chose qui attendait son moment d’émergence.
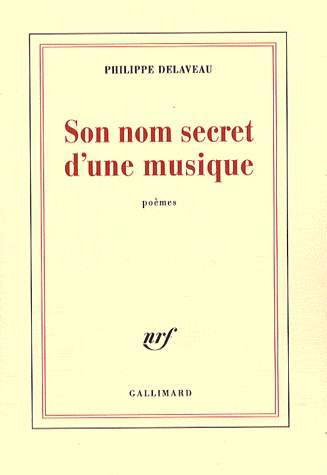
- Comment se manifeste pour vous l’inspiration poétique ?
Philippe Delaveau : Vous employez un mot délicat, qui a été l’objet de critiques sévères de la part des poètes, à cause de ce qu’il signifie dans les milieux les moins avertis : une sorte d’opération magique à bas prix par laquelle un écrivain se contente de recevoir un poème tout fait qu’on lui envoie par paquet cadeau. Certes, il existe quelque chose que ce mot tente de désigner maladroitement. Mais comme il est difficile d’en parler ! Ce sont des instigations sous des formes variées, parfois, dans leur aspect le plus fort, une sorte de fébrilité qui promet ce que l’on reçoit alors sans toujours le comprendre : des formulations brisées, fragmentaires, qui peuvent guider l’invention poétique. D’autres fois, seulement une sorte d’émotion autour d’un mot, d’un objet, de quelque chose dont on ne sait pas même ce qu’il est et qui s’apprête à remonter des profondeurs où il était caché : un rythme, une évocation, une image. Mais tout cela n’est guère qu’une sorte de promesse de poèmes, nullement le poème achevé, qui fait appel à ces coopérations complexes entre le poète et les mots qui l’appellent. Mieux vaut parler alors d’expiration, pour qualifier ce travail de montage, qui est le souffle sortant de l’âme ? du cœur ? du ventre ? du métier ? du poète – tout cela étant engagé ensemble, d’une manière infiniment mystérieuse. Ainsi l’intelligence ne joue pas ici le premier rôle, je veux dire l’intelligence critique. Mais l’intelligence artistique, qui soupèse et mesure les nuances imperceptibles, les effets de sonorité, de rythme, de mesure interne, et qui peut ne pas toujours comprendre la signification ultime de ce qui est dit. D’où la nécessité de conserver l’esprit d’enfance, qui est une sorte d’innocence de l’être par rapport à ses relations avec lui-même et avec le monde.

- Quelle est l’importance de la peinture et de la musique pour vous ?
Philippe Delaveau : Ce sont deux arts considérables, chacun dans leur ordre. La musique m’a toujours fasciné, plongé même dans des ravissements inouïs. D’ailleurs je cherche dans mes poèmes à réintroduire des éléments propres à la musique : le rythme, que les contemporains ont généralement proscrit, et les effets de longueur de syllabes (comme dans les « pieds » de la poésie antique). À dire vrai, je ne sais lequel des deux me touche le plus : tout dépend de l’heure et des conditions psychologiques. Il m’est arrivé d’écouter pendant des journées entières, quand j’avais sept, huit ans, des morceaux de Mozart, Beethoven, Schubert, à la campagne, allongé sur le parquet d’une chambre, et de ressentir violemment ces morceaux, répétés sans fin. J’aurais aimé me consacrer à ces deux arts, à la musique, très tôt, puis à la peinture.
La peinture est dans un premier temps plus proche, dans la mesure où elle relève de l’écriture, mais elle diffère en transcendant les mots. Ce que fait aussi la musique, qui est sans doute l’art le plus haut, le plus grand, le plus mystérieux, qui nous ouvre véritablement un autre monde.
La poésie, qui reste tributaire des mots d’une langue particulière, tire néanmoins sa grandeur de la primauté du verbe, comme il est dit dans la Bible : « Au commencement était le Verbe… » Mais la langue est radicalement blessée depuis la chute, depuis l’expérience si terrible de la Tour de Babel – et chaque langage de poésie cherche à remonter vers le verbe originel pour approcher le Verbe, si bien qu’il y a une grandeur douloureuse dans toute parole de poésie, dans toute grande profération de langue. Et le langage poétique considère avec émerveillement et envie les aptitudes de la musique ou de la peinture, plus proches de l’universel, moins atteintes par les conséquences de la chute – sinon dans les temps actuels, par la perte du « sens ». Mais s’il y a « sens », c’est donc avec des mots : la crise des arts plastiques est seconde par rapport à la crise qui frappe la pensée et la langue. Il existe néanmoins de belles entreprises de peinture !
J’ai eu la chance de pouvoir travailler à des livres avec quelques peintres, qui m’ont beaucoup appris de leur art – et de la poésie en retour, par ces démarches « croisées » où le peintre accompagne les mots du poète, ou l’inverse : le poète inscrit ses mots sur les peintures ou les gravures. Je songe ainsi à Baltazar, Laubiès, Bertemès, Hélénon, Chauder, Pardon, Pouperon, Youl, Alechinsky, Antonio Seguí, etc. Je serais ravi de pouvoir travailler avec des compositeurs !

- Quelles sont vos lectures aujourd’hui, lisez-vous les mêmes auteurs qu’auparavant ?
Philippe Delaveau : J’aime particulièrement le roman. Je lis même davantage de romans que de recueils de poèmes. Trop de livres de poèmes me tombent des mains… Si bien que je reviens toujours à ceux qui m’ont enchanté ! Et je m’aperçois qu’aussi bien pour les romans que pour les poèmes, je préfère de loin les auteurs étrangers contemporains aux auteurs français, sinon quelques-uns que j’admire indéfectiblement ! Ce n’est pas facile d’analyser ce qui manque aux œuvres écrites ces derniers temps en France, mais je constate le même défaut de l’une à l’autre. Disons qu’elles sont dépourvues de réalité, elles tournent à vide comme des moulins, elles font faire du bruit aux mots qui restent des mots, au lieu de se dépasser pour permettre à la « magie mineure » d’avoir lieu. Il faut qu’un bon roman nous transporte, que nous ne voyions plus les mots mais la scène à cause de la force de réalité des personnages. De même, un poème réussi doit provoquer en nous une émotion qui nous mette dans un état bien particulier. Il faut que le romancier ou le poète se laissent emporter par la vision profonde, qu’ils écrivent comme en rêve, qu’ils s’emparent alors de toute la réalité qu’ils ont ingurgitée – psychologique, matérielle, spirituelle – pour faire accéder à l’autre vie, la vie seconde, qui est celle de l’art.

“IL N’EST TEMPS D’AUCUNE HEURE”, poèmes de Philippe Delaveau, gravures de Julius Baltazar, peintures de Jean Cortot, Éditions Laure Matarasso, Nice 2008
- De quoi êtes-vous le plus fier ?
Philippe Delaveau : Je ne sais pas si j’emploierais l’adjectif que vous utilisez : « fier » ! Je préfèrerais dire de quoi je me « réjouis » ! De ma femme et de nos enfants ! Les vrais enfants, parce qu’une œuvre d’art ne sera jamais l’équivalent d’un être humain ! D’avoir reçu la grâce d’écrire les livres que j’ai écrits sans sacrifier la vie de famille – du moins je l’espère – contre l’avis ambiant qu’un artiste ne doit pas s’écarter de la seule tâche artistique ! Ce qui me semble une ineptie. Le regard que l’on porte sur soi, sur le monde est transfiguré de manière radicale par la relation amoureuse et paternelle. On ne voit plus les choses de la même façon quand on a reçu la grâce de la paternité – ou de la maternité pour les femmes ! Déjà, on commence par relativiser toutes les choses, à les situer dans leur vraie hiérarchie de valeurs ! D’ailleurs Jean-Sébastien Bach avait vingt-et-un enfants, si je ne me trompe, ce qui devait faire passablement de bruit dans la maison… Mozart aussi a fait l’expérience de la paternité. Plus près de nous, Bernanos avait cinq enfants ! Je me réjouis d’avoir rencontré celle qui devait devenir ma femme, une vraie littéraire, qui a accepté de vivre cette aventure qui n’est pas évidente, croyez-moi ! et dont le jugement et les conseils m’ont toujours été très précieux… Et qu’il m’ait été donné le temps et la force de pouvoir offrir à des étudiants ce qu’ils attendaient, en sacrifiant souvent les livres pour les conseils et l’attention dont ils avaient besoin, même si beaucoup d’entre eux ne se doutaient pas de ces choix douloureux !
- Votre péché mignon…
Philippe Delaveau : Je n’en ai pas qu’un seul, hélas ! et ils n’ont rien de mignon… Beaucoup de péchés, hélas ! disons, parmi les plus avouables, que je suis très gourmand !

- Un rêve à réaliser ?
Philippe Delaveau : Comme écrivain, oui, il y a ce rêve de parvenir au vers « absolu », qui manifeste tout ce que les poèmes ont tenté maladroitement et trop longuement de dire. Et puis de pouvoir achever tous les livres qui attendent, et qui envahissent ma vie quand je ne parviens pas à les écrire. Je sais de quoi je parle !
- Quel est le meilleur compliment qu’on puisse vous faire ?
Philippe Delaveau : Me dire qu’on se sent plus heureux après avoir lu un de mes livres. Surtout si l’on ajoute que l’on aura adhéré à une parole d’humanité et non pas à un jeu intellectuel. Que l’on aura partagé à travers la médiation du poème ce qui fait le lot des grandes expériences d’humanité, à travers les relations conflictuelles et complexes qui nous font traverser la souffrance pour atteindre la joie. Que cette lecture aura permis d’admettre qu’il existe un sens à tout ce qui est, à chacune de nos vies. Permettez-moi d’ajouter ceci : ce que j’ai reçu – et en particulier ce don d’écriture, il me vient d’un autre, du Tout-Autre ! Aussi le meilleur compliment qui pourrait m’être fait, je ne devrais pas l’accepter, mais dire, tout au contraire, que je ne le mérite pas : car je n’aurais pas réussi à faire ce qui est le moins mauvais si je n’avais pas reçu, comme tout artiste – mais beaucoup ne se doutent même pas du merveilleux don qu’ils reçoivent – le don gratuitement donné pour cette mission particulière de l’art !

Dans l’atelier de Julius Baltazar, décembre 2009
16. Quels sont vos projets à venir ?
Philippe Delaveau : Parvenir enfin à écrire les grands livres auxquels je n’ai pas pu m’atteler, et qui tournent dans ma tête comme des chauves-souris ! équilibrer enfin, selon une exigence de densité et de transparence ce que je pourrais considérer comme un poème tout à fait réussi ! Reprendre d’anciens poèmes et tenter de les retravailler pour supprimer tant de défauts qui me découragent maintenant qu’ils se découvrent à mes yeux avec tant d’évidence.
Pour en savoir plus sur Philippe Delaveau
Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Delaveau
Bibliothèque Nationale de France : http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/anx_conferences_2012/a.c_120514_delaveau.html
Le Printemps des Poètes : http://www.printempsdespoetes.com/index.php?url=poetheque/poetes_fiche.php&cle=483
Gallimard : http://www.gallimard.fr/Contributeurs/Philippe-Delaveau
SGDL : http://www.sgdl.org/social/223-presentation-des-personnes/2041-present-biographie-de-philippe-delaveau